***
4° de couverture
« J’attrapais chacun des mots d’Alice au vol. Pas un n’est retombé sur le sol. Ce qui est normal. Ses mots sont des oiseaux étranges. Et normalement, les oiseaux ne papillonnent pas. Elle attend tellement de la vie, Alice, elle cherche tellement des réponses, Alice…
Pas seulement l’amour. Ce serait trop simple. L’adolescente comme la femme, et peut-être la petite fille qui sommeille en elles deux, réfléchissent de concert sur la mystique de la vie. Elles font un voyage, dans la petite couronne de leur existence tout d’abord, puis dans sa grande couronne ensuite. Dans un train, l’amour ; devant un écran, la mort ; dans une chambre d’hôtel, la révélation qui fait que la jeune fille laisse place à la femme.
C’est quoi, cette arme, Alice ?
Que fait-elle entre tes mains ?
Quel est ce pari stupide que tu fais, à une contre six ?
II y aura des balles perdues, Alice, avant que le début des réponses à tes questions n’effleure tes oreilles.
Bang ! Bang ! »
**
Commentaire de l’Editeur
« Aurélie Lesage signe ici un livre magnifique, tendre et violent à la fois, mais aussi poétique et amoureux sur l’itinéraire d’une jeune fille bientôt femme, dans un contexte social troublant. Non seulement ce texte évoque les problèmes émotionnels et éducatifs de notre époque, mais en plus, il nous offre un conte urbain moderne d’un style littéraire remarquable. »
*
Ici, la Narratrice nous invite à faire un voyage en nous qui, en même temps, sera voyage hors de nous. Ou, ce qui revient au même, voyage en elle, hors d’elle. Car un nécessaire processus d’identification relie le Voyeur de l’œuvre à celle qui en a été l’initiatrice. De quel roman s’agit-il donc ? D’un roman de formation tel le « Wilhelm Meister » de Goethe où le héros de la narration doit faire l’apprentissage de la vie, évitant autant que faire se peut de chuter dans les ornières, de connaître les culs-de-basses-fosses, autrement dit de cheminer au bord du Néant sans se précipiter dans l’abîme ? Ou bien alors, toujours dans le même sillon goethéen, serait-il question plutôt d’une identique tragédie à laquelle le « Jeune Werther » se heurte dans le roman éponyme, choisissant la mort plutôt que d’endurer un amour malheureux ?
En réalité je crois qu’il s’agit des deux à la fois, initiation et drame mêlés. Si l’existence paraît aller de soi, lors des jours ordinaires, elle n’en est pas moins entachée d’une lourde empreinte métaphysique. Dans le livre, Schopenhauer, aussi bien que Beckett ou Cioran ne sont nullement cités à titre décoratif. Ils sont le signe de cette tragédie qui traverse la temporalité, que Miguel Unamuno en son temps avait nommé « sens tragique de la vie ». Oui, en filigrane et quoique le ton parfois enjoué du livre, souvent vivace, primesautier en maints endroits, paraisse affirmer le contraire, l’enjeu est bien de se situer sur cette ligne de partage hautement humaine, entre vie et mort. L’abîme n’est guère éloigné dont il faut que l’image nous habite, inconsciemment tout au moins.
Si la Narratrice paraît avancer dans la vie d’une manière tout à fait conventionnelle, son existence se calquant sur celle de ses semblables, l’on doit cependant discerner une inclination naturelle à l’inquiétude coalescente au sentiment d’une chute toujours promise. Ainsi, ce qui le plus souvent sonne à la porte de la chair, la sensation du Vide, l’intuition du Rien, la palpation d’un Néant qui, à tout moment, pourraient signer ‘la fin de partie’ beckettienne. Il y a toujours, au cours de la narration, comme une ‘petite musique de nuit’, sourde, ourlée d’inquiétude. Il existe, originairement, une faille, une césure constitutives de ce mal être que Baudelaire nomma ‘spleen’, qui n’est nullement la marque d’une époque, mais le signe universel d’un mortel ennui gravé au plus abyssal de la conscience humaine. L’être, qui par essence s’y confronte toujours, cherche une solution à ce motif d’angoisse : soit il fuit et se réfugie dans quelque mensonge, soit il fait face et demande à la vérité de répondre des actes des hommes.
Chez ‘Alice’, le souci de la recherche d’une vérité est patent, il constitue une manière de fil rouge qui court au long du récit, sans en entraver la marche en avant, mais suffisamment présent pour qu’on en perçoive le constant murmure. Elle (La Narratrice), se moque des apparences et des affèteries, des bals costumés et des visages grimés. Elle se conforme bien davantage à un ‘état de nature’ rousseauiste, négligeant le plus souvent de se conformer à la norme sociale et à ses contraintes qui ne sont que restriction de la liberté individuelle. Quête de liberté qui rime avec celle de l’identité. S’affirmer, certes, mais dans un genre d’autonomie qui ressemble à la maïeutique socratique : Elle veut se connaître en accouchant d’elle, Elle veut SE créer au monde, tout comme une écriture sort de soi et prolonge au dehors les plis d’un éternel mystère dont nul ne pourrait avoir la clé, pas même le Sujet qui est agi par elle, l’écriture, plus qu’il n’agit sur elle.
Mais, toutes ces précautions d’usage prises en conscience, Elle ne saurait demeurer en retrait du monde. Toujours l’on part de sa propre origine, ce Principe singulier pour aller vers l’Autre, cet autre Principe qui nous fait face en son énigme. Son propre Principe, on le perçoit comme une eau de source limpide, comme une lumière non altérée par quelque nuit, comme une Essence dont il faut garder la virginité le plus loin possible. Oui, car perdre sa virginité, pour Elle, c’est accepter que son propre Principe lumineux s’ourle de l’ombre d’un autre Principe. Il y a toujours danger à transgresser son intime unité pour en connaître une autre qui amènera du différent, du trouble, de l’inaccompli. Aussi, Elle est-elle prudente quant au fait de rencontrer l’Autre dans sa chair, dans son esprit, au plein même du cocon de sa vie.
Mais rien n’est désespéré, une médiation est possible, elle porte le beau nom d’Amour. Oui, et cet Amour, en sa jeune conscience, en sa neuve innocence, il faut en faire déployer l’oriflamme au plus haut. En faire une « étoile », en faire un « diamant ». Car pour Elle, dans son attente idéale, Amour ne peut que rimer avec Absolu. Deux transcendances qui se rencontrent et jettent aux orties les tribulations de toutes les contingences. Mais, bien évidemment, tout ceci n’est énoncé qu’à la hauteur du Principe de plaisir. Bientôt le souverain et inéluctable Principe de Réalité gommera la fleur de lotus du rêve pour ne laisser subsister que l’eau grise et boueuse du marécage sur lequel elle prend son essor. Que faire alors pour la Narratrice, sinon chuter de l’innocence originelle pour se ruer corps et âme dans le derme existentiel, avec ses clartés et ses ténèbres. Conjuguer l’amour, le désir, le plaisir à l’aune de tout ce qui constitue l’habituel cocktail de la mondanité.
Expérimenter tout ce qui, en apparence du moins, constitue un possible ilot de bonheur ou du moins une absence de malheur : le sexe, la drogue, la fugue, la rupture, l’alcool. Mais Elle s’apercevra bien vite que tous ces ingrédients sont frelatés, qu’ils ne sont que les piètres faire-valoir d’une joie qui, elle, est bien plus haute, seulement accessible à l’aune d’une peine, sinon d’une souffrance. Car à désirer mollement on récolte mollement. L’Amour, Elle le dessine en elle porteur des plus belles faveurs qui soient. Elle tresse une couronne de lauriers à ses amants successifs, mais rien n’y fera, le réel en son naturel têtu abolira les vertus émollientes du songe. Michael est « là, c’est tout », avec Baptiste « l’amour c’est un peu comme Dieu, c’est une idée, un concept, jamais une sensation », avec Félix, l’étoile avait brillé un instant puis s’était retirée dans la mort, « on est seul avec son silence. »
L’existence serait-elle cette immense désolation, ce désert sans vie, cette étrangeté dans laquelle on finirait par disparaître comme un nuage poussé par le souffle de l’Harmattan ? Non, une ressource existe en soi. ‘Alice’, derrière sa silhouette, se dessine un ‘Pays des merveilles’. Un pays de magie où réaliser tous ses rêves, oublier les tracas du quotidien. Ce pays est semé d’étoiles qui brillent au firmament, ce pays connaît l’Amour en ses plus beaux atours, ce pays est celui des songes de cristal et des écritures célestes, celui des mystérieux hiéroglyphes qui conduisent à soi tout en montrant le chemin vers l’autre.
Elle, la Narratrice est sous le charme permanent d’une voix venue du plus loin de l’espace, du plus loin du temps. Elle est une fabuleuse polyphonie, un chant de Sirènes, peut-être la Musique des Sphères issues de l’illisible cosmos, elle est la geste enchantée de Cupidon, elle est le tissu même du songe dont Nerval disait qu’il conduisait à ces « portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible », elle est l’irréel en sa douceur de soie, elle est la voix de la conscience de la Narratrice, cet étrange monologue en boucle, ce retour sur Soi jusqu’aux portes de l’ivresse, de l’extase. Oui, car il y a légitime exaltation que de porter le Soi au plein du Soi, de le désigner comme lieu de toute jouissance, aboutissement de tous les désirs, finalité de tous ses actes. La véritable extase n’est jamais que ceci : coïncider parfaitement avec son être et devenir une monade heureuse de Soi, le foyer d’une joie.
Seulement, un jour ou l’autre, après qu’une dure épreuve a été franchie, qu’un amour a échoué, qu’une peine a été ressentie, il nous faut consentir à marcher sur le chemin de poussière terrestre, à y inscrire la trace mortelle de ses pas. Alors on n’est plus seul. Alors Elle n’est plus seule. Elle est hélée par les autres présences, elle est appelée à témoigner parmi la multitude, à trouver sa place dans le grand carrousel du monde. Ainsi l’ego sera-t-il reconduit à sa plus exacte tâche de devenir un alter ego. Suivre l’assertion rimbaldienne, la métamorphoser en injonction pour soi « Je est un autre ». Si l’autre de Rimbaud était la poésie, pour la Créatrice de cette œuvre-ci, Alice est cette autre qu’il faut rejoindre. Rejoindre de quelle manière ? Mais par le geste de l’écriture qui, seul, peut la sauver (nous sauver) des apories les plus pernicieuses.
« Nous sommes l’autre que nous écrivons », ici se donne sans doute la clé de compréhension la plus efficiente « d’Alice aux petites balles perdues ». Alice est la médiatrice qui, arrachant à elle Celle qui écrit, la reconduit à sa plus propre essence, à savoir à la plénitude d’être sans reste sous la dictée du ciel, sous le recueil de la terre. Toute création est de principe divin qui unit ciel et terre dans une seule et même réalité. Au ciel demeure Alice, sur terre demeurent la Narratrice, Celle qui lui a donné la vie, nous Lecteurs à qui est confiée la tâche redoutable d’interpréter les signes. Nous ne sommes que par eux, suivant en ceci la belle et profonde remarque hölderlinienne tirée de son poème ‘Mnémosyne’ : « Un signe sommes nous, vide de sens… ». A nous de le donner, ce sens. Le faisant, c’est au nôtre que nous accédons sans délai.
Quelques extraits « D’Alice aux petites balles perdues »
Sur l’amour :
« J’ignore où il se trouve. Est-ce lorsque mon cœur bat plus fort, qu’il fait mal ? Est-ce dans la solitude d’un champ en fleur que je pourrai enfin te toucher ? La nuit est toujours pâle, mais l’ombre des rayons se fige au-delà de mon corps posé sur le lit noueux d’un lac. Il est une étoile qui dissimule nos espérances, la brume de la nuit naissante recouvre la vérité, nous croyons voir la lumière, mais au moment où je regarde dans le ciel, cette étoile est déjà morte. La lumière éblouit mon regard attardé, déformé, en retard, incapable de se poser sur un véritable amour naissant. »
Sur l’acte d’écrire :
« J’aimerais prendre le temps de saisir une main pour y dessiner, sur le revers de la paume ouverte de ma victime, une multiplicité de lignes. Des lignes qui se joignent, se nouent, se défont. Tout un réseau de signes mêlés entre eux, où l’envers des phrases se reflèterait dans un endroit insolite, uniquement connu de moi, et vous seriez là, à mes côtés. Vous m’accompagneriez silencieusement dans chacune de mes actions, les plus belles, les plus spontanées, les plus sincères, celles que j’inventerais. Ma main tremblante fabriquerait cet endroit, elle décrypterait en plein vol la réverbération des lettres contenues dans un simple mot et peut-être que j’écrirais. Oui, peut-être que j’écrirais, enfin, pour de vrai ! Mais je suis ici, seule, emmurée dans mon silence. Ivre, j’irai danser et chanter, ce soir, l’air de rien, comme toujours, l’air de vivre, l’air du temps. »
Sur la sensation :
« Quand tout sera léger, vois-tu, je t’écrirai. Je suis comme les oiseaux déchirés par la foudre. Depuis combien de temps n’ai-je pas rencontré le soleil ? Cette jolie boule de feu devait dormir dans mon ventre et se réveiller pour enfanter mille étoiles. Mille et pas une de plus ! Car au-delà, au-delà, il y en aura une infinité, rien ne s’arrête jamais. Les mots viennent sans préavis, ils sont comme la flamme, celle qui nous brûle, la vraie. »
Sur la création :
« Ecris et crie le visage de l’autre… le visage de toi. Un jour, ma main viendra effleurer tous tes rêves, alors tu comprendras qu’il est temps de créer. La vie se posera sur ton cœur attendri. Et l’amour infini coulera dans tes veines. Tes désirs produiront des étoiles bleutées, où l’orange n’est amère que pour ceux qui perdent. J’aime intensément, comme la vague ruisselante qui s’enroule à nos pieds. Mon artiste, mon âme, mon art pour t’écrire les mots qui ne viennent pas, je tombe en amour et m’élève jusqu’à nous. Je pétris la chair molle de nos histoires futures. J’avance jusqu’au sommet des montagnes enneigées. Il n’est pas de défi que je refuserai. Alice, tu as été l’étincelle innovante, as-tu appris de tes erreurs ? Deviens l’artiste de ta vie et ne laisse personne étouffer ton désir. »

/image%2F0994967%2F20201219%2Fob_f4431f_capture.JPG)


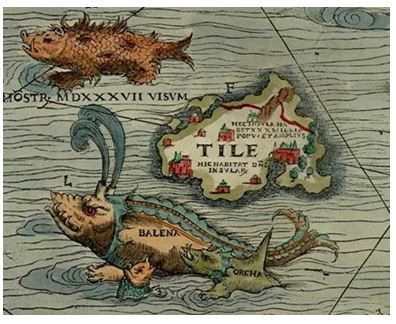


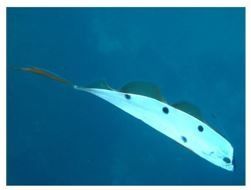
/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)