(Bref essai d'intertextualité [d'inter-picturalité]
entre une œuvre d'Elsa Gurrieri
et une œuvre de Gilles Molinier)
Œuvre : Elsa Gurrieri
***
Ce qu'aimait faire Aurora, ceci : se poster à la lisière du monde et regarder. Regarder jusqu'à l'évanouissement, jusqu'à la perte de soi dans des corridors de brume. Voir était une fascination. Il y avait tant de beauté partout présente qu'il fallait archiver dans les feuillets de la mémoire. Le soir, lorsque les ombres devenaient longues, Aurora grimpait en haut de la colline, là où les herbes dansaient sous le vent. Elle s'adossait à un arbre - à l'un de ces arbres dont elle était une manière de prolongement -, et clouait ses yeux au cercle agrandi de la clairière. Partout la lumière baissait et, maintenant, ce n'étaient plus que quelques filaments faisant leur lacis d'argent sur la dalle lisse de la mer. Le village luisait encore, piqueté des étoiles des réverbères. Il y avait si peu de mouvement qu'on aurait cru à un commencement du monde. A moins que ce ne fût à une fin.
Tout reposait et la cadence des hommes avait enfin trouvé son point de chute. C'était un mystère que de fixer la braise de ses yeux sur le peuple des grands arbres. Il suffisait de se laisser gagner par leur houle si lente à se mouvoir. Au-dessus de leurs têtes déjà prises de sommeil, c'était comme une manière de nuage d'écume, un reste de clarté posée sur le silence des frondaisons. Une rumeur, un murmure, une à peine oscillation de la meute végétale. Aurora sentait en elle, à l'intérieur de la grotte de son corps, glisser longuement ces lacets de lumière qui détouraient les contours des pins parasols et des chênes-lièges. C'était une seule et même harmonie, du monde, de soi, du sens partout répandu. Quelques flaques plus claires traînaient au ras du sol, se mêlant aux coussins de mousse, aux cheveux hirsutes des lichens. Bientôt, à l'ouest, le soleil ne serait plus qu'un vague souvenir alors que les derniers feux s'éteignaient dans les foyers noyés de cendre. Le domaine de la nuit avançait, faisait ses lacs sombres, ses filaments de bitume, ses remous d'algues brunes. Le globe de la lune, hissé en plein ciel, les étoiles aux yeux inventifs, la brise du large se balançaient à l'unisson, immense clapotis qui semblait vouloir dire la perte de la parole humaine, la parution de la poésie aux étranges confins. Tout s'irisait à l'infini, tout glissait calmement sur la courbure des choses. Puis, la nuit se faisait plus dense, cotonneuse, enveloppant tout dans une taie étroite, genre de langage venu dire l'instant unique, la vision qui, jamais, ne se renouvellerait.
Les arbres avaient déserté leurs cimes, ils n'étaient plus que racines faisant glisser leurs tiges blanches dans des tunnels de limon. L'univers du sol livrait ses tapis d'humus, les taupes aux livrées soyeuses avançaient sans bruit, les eaux souterraines brillaient de l'intérieur, les grottes de calcite ouvraient leurs parois de phosphore. C'était comme si la terre, soudain devenue aussi mince qu'un isthme pris entre deux océans, se fût livrée dans son entièreté, en un seul empan de glaise souple et humide. Là on était bien, lovée au creux de la confiance, abandonnée au luxe de la présence. Là on était bien où l'on aurait pu demeurer une éternité, le balancement du nycthémère faisant son rythme de chrysalide. Tout en attente du déploiement, tout dans l'irrésolution prénuptiale de la nuit finissante, du jour non encore parvenu à sa parution. Tout dans tout, identiquement à une longue immersion dans des eaux amniotiques au long cours.
Œuvre : Gilles Molinier
*
Mais bientôt serait l'aurore et sa lueur à peine plus haute que le chant du grillon. Bientôt serait la révélation des choses en leur étrange singularité. Aurora, postée dans le recueillement de sa silhouette, avait la discrétion d'un céladon luisant dans la pénombre d'une cloison huilée, translucide. Un presque effleurement de soi dans l'événement à venir. Une saisie de ce qui s'annonçait alentour avec la persistance à être d'une simple évanescence. Tout paraissait tellement commis à une prochaine perte. Alors Aurora laissait son corps se dilater aux dimensions de l'espace. Elle abandonnait sa posture racinaire, elle se hissait au-dehors de l'antre terrestre, elle surgissait du ventre de l'argile afin de féconder le ciel, d'ouvrir aux hommes l'arche brillante de leur destin. Car Aurora était cette 'inquiétante étrangeté' dont les Vieux Hommes aux palabres, vêtus de noir, sous les bouillonnements de l'arbre aux paroles, prétendaient qu'elle était un elfe, ou bien une fée, ou bien un démon commis à leur propre perte. Mais peu importaient les radotages des joueurs de tarots : ils voyaient en toute chose la main prémonitoire qui, un jour les frapperait, les distrairait à jamais des signes mondains. Ils étaient hautement mortels, promis à la finitude et, ceci, ils ne l'acceptaient que du bout de leurs lèvres urticantes, de l'extrémité de leur âme cavernicole.
Cependant que le jour commençait à poindre, une hésitation faiblement colorée à l'orient, une traînée de lave sur la mer, un glissement hors de soi des failles abyssales; Aurora habitait maintenant le faîte des arbres. Elle était balancement au-dessus des épis sombres, elle était ramure et lumière argentée parmi les dérives du monde, elle était l'arbre et la forêt, le tronc et l'écorce, le centre et la périphérie de tout ce qui paraissait dans l'incertain du poème. Bientôt l'infini langage du ciel féconderait la terre en une union que, jamais, les mots ne pourraient porter à révélation, pas plus que les gestes n'en dessineraient la forme, ni les yeux n'en décideraient le contour. C'était une question d'âme, une somptueuse affinité qui dressait sa liane depuis le corps intime de l'exister jusqu'aux limites du compréhensible. Comment dire cette prodigieuse manifestation de l'annonce de la lumière alors que les hommes encore livrés au sommeil et au rêve dérivaient longuement sur leurs nattes d'envie ? Comment dire cela qui surgissait depuis la nuit des temps et, jamais, ne serait nommé ? Peut-on dire la nuit finissante, peut-on dire le jour naissant ? Peut-on dire le mince fil qui les relie, le passage qui les anime, l'unique don qu'ils portent en eux à la manière d'une offrande multiplement renouvelée ? Peut-on dire l'être de l'homme, du monde, des choses, autrement qu'en s'immergeant dans ce réel qui nous comble en même temps qu'il se dérobe ? Peut-on dire quoi que ce soit du vivant et ne pas tomber dans une simple pantomime ? Peut-on ?
La bascule de la nuit a eu lieu, la merveille du jour lui faisant suite. Aurora, pieds nus dans la poussière d'or, redescend les marches de schiste qui conduisent au village. Quelque part, loin sur la mer, une tache claire semble témoigner de l'unique, de l'étonnante ouverture du manifesté en son essence. Déjà, sous l'arbre à paroles, les langues se délient qui disent l'urgence à se saisir des choses. A les porter à leur incandescence. Mais il est toujours trop tôt ou bien trop tard pour pouvoir coïncider avec l'arche du temps qui fait ses remous et ses cataractes, ses ruisseaux qui coulent en nous avec la douce insistance de l'imperceptible. Il ne reste plus qu'à s'en remettre à soi, à gagner l'en-dedans du monde tout comme le fait Aurora, campée tel un sémaphore sur l'extrême pointe du jour. Sentir en soi, dans les mailles rubescentes des tissus, dans la complexité des faisceaux de myéline, dans la turgescence des cerneaux gris, cet éternel passage de la lymphe, ce lent écoulement de la sève, cette confluence qui dit, en même temps, notre essence racinaire, aussi bien que notre disposition aux ramures, à savoir l'efflorescence de notre liberté. Cela, nous les Arbres levés dans l'azur, ne pouvons le percevoir qu'à assumer notre immense solitude, là, tout contre la clairière où se brise la nuit sur les vagues de clarté. Toujours, il est possible de témoigner, tant que, devant nos yeux éblouis, se dessine l'estompe du présent, le voile du passé, la vibration de l'avenir. Arbres aux racines profondes, aux troncs tortueux, aux larges feuillaisons faisant leur dérive parmi les lames d'air, nous ne vivons qu'à nous élever encore, comme Aurora, vers ce qui nous appelle, qui est poésie étendue d'un bord à l'autre de l'horizon. Cela, nous le pouvons. Cela, nous le voulons !

/image%2F0994967%2F20210724%2Fob_a975fb_1-copier-copier.JPG)
/image%2F0994967%2F20210724%2Fob_1cf350_2-copier-copier.JPG)

/image%2F0994967%2F20210628%2Fob_7966c5_1.JPG)
/image%2F0994967%2F20210628%2Fob_64a8c8_2.JPG)
/image%2F0994967%2F20210421%2Fob_c3d508_1.JPG)






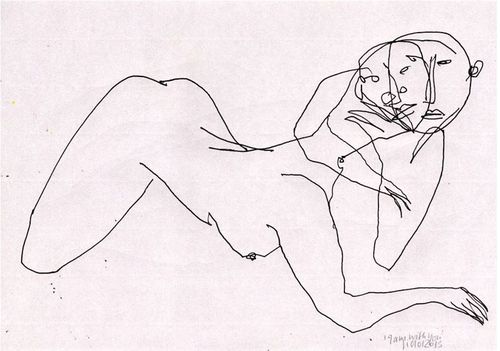








/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)