Café El Patio.
Synopsis
Lieux et personnages :
La Cité Autan : lieu dévasté, tout près de grands entrepôts, où sont casées, dans des logements de fortune, des familles de cas sociaux, pour la plupart vouées au chômage.
La Bastide, belle et hautaine ; ville où habite une population bourgeoise, à la périphérie de
laquelle se trouve Autan.
Entre les deux : Le Terrain vague squatté par des Gitans.
******************
5 OCTOBRE
Venu des plaines d’herbe, le vent souffle continuellement depuis plusieurs jours. Un vent blanc, acide, qui balaie les grandes dalles de ciment de la Cité Autan, use la peau, clôt les lèvres, oblige à cligner des paupières. On se terre dans les cubes de béton, serrés autour des poêles et les conversations rougeoient faiblement, comme des braises sous la cendre. Sur le grand parvis de gravier, des chiens errants et faméliques glissent à côté de leurs ombres, marchant de guingois, comme s’ils se méfiaient d’eux-mêmes. Un peu de vie encore du côté des entrepôts où les flèches des grues oscillent en grinçant. Puis le ronronnement circulaire des bétonnières, la chute sourde du sable coulant des bennes. A intervalles réguliers, le claquement des portes de tôle de la cité, quelques bribes de conversations, le choc des boulets de coke dans les seaux de zinc. Puis le silence à nouveau, lourd, plombé, arc-bouté sous la meute assidue des rafales. Plus loin, vers la Bastide, le Terrain vague est parcouru de longues ondulations, sortes de sillons d’écume qui glissent entre les roulottes, faisant des remous de poussière et de feuilles et le ciel se couvre de rouille et l’air se tisse de lames aussi drues que des voiles.
Derrière une butte de terre et de goudron, la carriole de planches et de tôles des Stanescu. Il y a peu de mouvement, peu de bruit à l’intérieur, sous la lumière opaque de la lampe à gaz. Juste un grésillement qui se hausse imperceptiblement au dessus des respirations alternées, des toux rauques, des raclements de gorge. L’air dense comme de l’ouate. Si réel, si palpable, qu’on pourrait en faire des boules et les laisser tomber au sol à la manière de flocons de neige. Au travers des rideaux de calicot, on aperçoit le village de roulottes. Circulaire, avec une sorte d’échancrure, d’échappatoire vers la Bastide, ses lourds remparts d’argile. Au centre, le campement rouge et vert de Luana, la doyenne des tsiganes, celle qui détient l’autorité, qu’on consulte pour ses secrets, ses recettes de bonne femme, ses conseils, sa sagesse aussi.
C’est Djamil, le père qui parle le premier et, dans la fraîcheur qui tombe, ses paroles sont des fuseaux de vapeur montant vers le plafond où courent les ombres grises. Ses mots franchissent la barrière des dents, des lèvres, avec lenteur, hésitation, genres de bulles qui éclatent dans la cendre à peine visible du jour. Djamil se plaint de l’usine de bois qui l’emploie si rarement, sauf parfois après les tempêtes, lorsque les grumes sont à terre, encore pourvus d’éclats de branches et qu’il faut enlever les écorces à la plane, les charger au levier sur les remorques puis fixer le chargement avec les cordes de chanvre. Alors les mains sont usées jusqu’à la trame, parcourues de lézardes bleues et deviennent fibreuses, semblables au bois qui les a meurtries. Il n’y a pas eu d’orage cet été, les arbres n’ont pas souffert. Ni hêtres ni charmes à abattre et si peu de troncs à scier. Trois, quatre jours de travail par mois. Puis le reste du temps à errer dans le Terrain vague, à donner des coups de pied dans les pierres ponces, à monter vers les carrières, jusqu’au « Volcan », grand trou circulaire où l’on trouve parfois des cartons, de vieilles planches que l’on fait brûler sur place et l’on suit longuement du regard les filets de fumée qui se fondent dans l’air bleu, aspirés par la taie immobile du ciel. Et l’on enfouit les mains dans ses poches et l’on serre ses doigts sur le dernier billet, on joue à user, les unes contre les autres, les rares pièces qui en tapissent le fond. Cette rudesse, cette âpreté de la vie, Djamil les a en lui comme les rochers sont tapissés de mousse et il sait que son quotidien est l’aboutissement de la longue dérive du peuple des tsiganes.
En lui sont gravés les stigmates : sur sa peau couleur de brique, dans ses yeux sombres comme la nuit, l’arc charbonneux de ses moustaches, sa façon même de marcher, de parler, de respirer, de faire grincer les cordes du violon, de plier les soufflets de l’accordéon lorsque la grande confrérie des Roms se réunit. Cela il le sait jusque dans les fibres les plus secrètes de son corps et il ne s’en plaint pas. Pourquoi se plaindrait-il d’être lui-même, d’appartenir par ses racines à ce peuple de parias, d’intouchables qui viennent de si loin ? Pourquoi renierait-il cette si belle diaspora qui porte en elle, aux quatre coins du monde, un sang semblable au sien, une peau, des yeux, des mains, une manière de se déplacer comme le vent, d’aimer avec violence, de danser autour du feu de bois, au milieu des étincelles qui sont comme des parcelles vives de son esprit, de son être ? Tout cela il l’a accepté depuis la nuit des temps et c’est devenu un second souffle, une haleine, une respiration qui n’aurait plus conscience d’elle-même et existerait dans le genre des feux follets ou des bulles irisées qui habitent la face des lacs. Tout cela il l’admet à la façon d’une fatalité, d’un destin et souvent même il est heureux à la seule pensée de son existence modeste, en marge, glissant dans la rainure de la vie sans faire plus de bruit que la chute des feuilles sur le sol d’automne.
Ce qu’il n’accepte pas, ce sont les regards qui le fuient, les mains qui l’évitent, tous les faux-fuyants, les faux-semblants, les dérobades de ceux de la Cité Autan, les attitudes hautaines des habitants de la Bastide, le peu d’intérêt des employeurs à son égard. Alors le chômage enfonce son coin au centre de sa tête, la faim vrille son ventre, l’angoisse fige ses muscles et les journées sont longues et grises à tourner au centre du cercle des caravanes, sous l’œil invisible de la conscience tsigane. Dans la chute lente et oblique des jours, les heures sont des lames acérées, les minutes des aiguilles chauffées à blanc. Et tout se met à vivre autour de Djamil avec la sombre attirance du vide, les roulottes, les falaises blanches, les entrepôts, les murs d’argile de la Bastide, la barrière des saules et des bouleaux à l’horizon et la vie n’est plus que cette infime palpitation au creux de l’ennui, cette étincelle si légère que la moindre brise pourrait l’éteindre.
Djamil sent le danger tout près de lui, à la façon d’un aigle au dessein funeste dont il serait la proie et le moment est alors venu pour les flammes noires de l’assaillir, et les idées les plus folles se logent dans sa tête avec obstination. Dans la caravane où les ombres grandissent, le regard de Kalia, la mère, traverse le calicot sans même le voir, pas plus qu’elle n’aperçoitLyubina, son unique fille occupée à caresser distraitement la fourrure noire du chat. Soudain l’air est lourd, tendu, comme les soirs d’été avant que l’orage n’éclate. Les éclairs ne tarderont pas à surgir, à traverser la roulotte d’une lumière mauvaise, chaotique. La voix de Djamil gronde, semblable à la chute de galets. Depuis longtemps déjà Kalia avait le pressentiment de cette parole qui déchirerait un jour le silence, de ces mots cernés de mort et de néant.
Djamil : « Pas plus tard que demain, Lyubina, tu iras au Café El Patio… »
La phrase s’interrompt, hésitante, ambiguë, projetée au dehors en même temps que retenue dans quelque pli de la raison.
Kalia : « Non, Djamil, tu ne peux pas imposer à Lyubina d’aller mendier. Elle est trop jeune et puis c’est indigne d’elle, de nous, de notre peuple qui doit avoir plus de fierté. On ne peut pas se laisser aller à la facilité. Et puis c’est malhonnête. Nous autres, Roms, ne pouvons plus vivre de rapines, de vols à la tire, de menus larcins, de poules dérobées. Nous devons avoir plus d’honneur. Nous devons trouver du travail, c’est notre seule façon de nous intégrer, de ne pas nous faire rejeter. »
Djamil : « Pas si simple, Kalia. L’ usine ne veut plus de nous, ne veut plus de moi, Djamil, l’homme à tout faire. Tout le monde se méfie des Roms, même les honnêtes gens. »
Kalia : « Tu peux aller scier du bois en forêt, te louer dans des fermes, être manœuvre au chantier de tôles. Tu es assez fort pour ça. La mendicité c’est le pire, c’est renoncer à être nous-mêmes, perdre notre identité et cela nous ne pouvons l’accepter. »
Djamil : « Ce matin, à la Caisse de chômage, on m’a dit que ce n’était pas la peine de revenir avant six mois, peut être plus, à cause de la crise, de la fermeture des usines, qu’on me préviendrait, qu’on avait mon adresse. Et quand l’employée m’a dit cela j’ai vu son regard teinté d’hostilité et de haine me traverser de part en part. Nous sommes des réprouvés, Kalia. Tous ceux qui, comme nous, ont le teint cuivré, les sourcils épais, les cheveux noirs, le regard sombre, on les ignore, on les envoie rejoindre la nuit dont ils sont issus. »
Kalia : « Toi, Djamil, tu pourrais jouer du violon à la terrasse du Café El Patio. Tu sais si bien jouer et la musique tsigane est si belle. Je suis sûre que ça te conviendrait et tu pourrais, de temps en temps, ramener quelques pièces. Ce serait toujours ça de plus pour les fins de mois, la vie est si rude ! »
Djamil : « Non, Kalia, tu n’es pas réaliste. Je ne t’en ai jamais parlé mais je suis déjà allé devantEl Patio, là où se réunissent chaque soir les hommes et les femmes de la Bastide. Les hommes dans leurs vêtements si blancs, les femmes voilées de noir. Tous et toutes des élégants à la vie si mystérieuse, si éloignée de la nôtre. Je leur ai offert mon plus beau répertoire, je leur ai joué des musiques de notre peuple, celles qui parlent d’argent, des femmes et de la douleur, de l’amour et de la haine, des chansons de Nicolae Kuta, de Constanta Boreraziu, de Cristi Antonescu, et tu sais ce que j’ai gagné, Kalia, des quolibets, des injures, des menaces. Et Hilal, le serveur, m’a fait comprendre que j’étais un indésirable, que la société de la Bastide et la nôtre, celle du Terrain vague, c’était comme si on mélangeait l’eau et le feu et qu’il n’y avait pas de place pour les deux dans un même lieu. Je ne suis plus jamais revenu à la terrasse d’El Patio, je n’ai plus jamais osé pénétrer l’enceinte de briques. Il y a une frontière, une ligne infranchissable, comme si nous étions faits d’une matière différente, si l’air que nous respirons n’était pas de même nature, si nous vivions sur deux planètes éloignées. Depuis ce soir-là, mes nuits sont livrées à la peur, au ressentiment, sans doute aussi à l’idée de revanche, peut être même de vengeance.
Kalia : « Tu vois, Djamil, nous autres Roms n’avons rien à faire à la Bastide. A plus forte raisonLyubina qui sort à peine de l’enfance. »
Djamil : « Mais, au contraire, notre chance c’est d’avoir Lyubina, si jeune, si frêle qu’elle ressemble simplement à une petite fille qui aurait trop vite grandi dans ses vêtements. Elle a l’excuse de l’enfance, pas nous. Et tu sais, je vais te dire ce que m’a confié Matéo-le-Gitan, à propos de Boti, la plus jeune de ses filles. Eh bien Boti va souvent à la terrasse du Café, habillée des vêtements traditionnels, juste accompagnée du doba qu’elle frappe en cadence, faisant vibrer la peau de son tambour et carillonner ses cymbales. Boti chante et danse si bien qu’elle enchante et charme ceux de la Bastide qui ne voient en elle que la grâce, la naïveté et non un perfide calcul des Roms qui pourrait troubler l’harmonie de leur vie. Alors, parfois, les hommes, les femmes, pris au piège de la musique tsigane, envoient une pluie de pièces qui brillent comme l’or et des billets aussi légers que des papillons. Aussi Matéo-le-Gitan n’a plus besoin de se lever à l’aube pour aller dans les champs ou les bois, plus besoin d’aller s’enfumer chez le charbonnier pour quelques misérables pièces. Boti, c’est la providence de Matéo, celle qui lui permet d’échapper à sa condition, de vivre enfin comme un homme debout. Et Matéo a un projet. Bientôt, quand il aura suffisamment d’économies, que le trop plein de la Bastide aura empli ses poches, il vendra sa roulotte à un autre gitan et il ira habiter une maison, tout près des remparts. Il me l’a montrée,Kalia, et tu ne peux même pas l’imaginer. Aucun tsigane n’a jamais habité dans une telle maison ; aucun n’a jamais osé en rêver. Le rêve, c’est si loin du Rom qu’il n’en perçoit même pas les contours. Il se contente de penser que cela existe et que, peut être, un jour, le destin s’inversera, et alors la communauté bâtira tout un village et les Roms ne seront plus vraiment desRoms, plus des nomades que l’on chasse et qui se réfugient de ville en ville, dans des zones de crasse, de déchets, de plaques de bitume lépreuses, tout près des cases de ciment, comme ici dans le Terrain vague où nous ne sommes guère plus que des animaux errants et plus personne ne nous voit vraiment. Alors, crois-moi, notre fille est notre planche de salut. Elle est si belle, si enjouée, si habile avec son corps, tellement en harmonie avec la musique. Et puis sa voix, si sensuelle, haute et grave à la fois, voilée à la manière d’un chant qui viendrait à travers les âges, peut être depuis notre Inde natale jusqu’ici, au milieu des herbes folles, pour porter le message du peuple voyageur, du peuple sans racine, du peuple des oubliés. Elle est aussi habile que Boti, aussi vive, aussi gaie, toujours disposée à chanter. Alors pourquoi ne réussirait-elle pas ce que son amie a appris à mettre en pratique en quelques mois ? Kalia, le doba que m’avait offert mon père est toujours dans le coffre au fond de la roulotte ? Attrape-le donc que Lyubina nous montre qu’elle n’a pas complètement oublié la danse des Tsiganes, leurs chants millénaires, le rythme des mains sur la peau tendue. »
La nuit d’automne est tombée maintenant. Blanche sur les dalles de la Cité Autan ; couleur d’argile au dessus de la Bastide ; couleur de suie sur le bitume du Terrain vague. Pendant l’explication de Djamil, Lyubina est restée silencieuse, perdue dans ses pensées. Elle a perçu la ferme intention de son père de l’envoyer mendier à l’intérieur des remparts, là où habitent les hommes et les femmes qu’elle n’a jamais rencontrés, dont elle a seulement entendu parler. Elle sait déjà que sa mère se rangera à l’avis de Djamil. On ne s’érige pas contre la volonté d’un Rom, on la subit comme une loi de la nature, une vérité, une évidence.
Dans le grand coffre, sous le lit du couple, Kalia sort, à la façon de précieuses reliques, le doba de Dezso, le père de Djamil. Sa peau est tendue comme la lame d’un curi, ses cymbales étonnamment brillantes sous la blancheur de la lampe. Sans que personne ne le lui demande,Lyubina se lève, se saisit du doba, fait ricocher ses doigts sur la membrane qui se met à vibrer, à résonner dans l’enceinte de planches et de tôles, alors que la voix aussi douce qu’une flûte indienne s’élève de sa mince poitrine, et c’est une liane qui se déploie dans l’espace, projette ses ramures, enroule ses vrilles et bientôt il n’y a plus que cela, au milieu des roulottes du Terrain vague, cette seule et unique voix qui se hisse, traverse la mince paroi du toit, se dilue dans la nuit bleue comme si elle était une germination, une pousse minérale, une concrétion de la conscience tsigane.
NUIT DU 5 AU 6 OCTOBRE.
Il n’y a plus de bruit sur Autan, sur le Terrain vague et c’est tout juste si l’on perçoit le glissement de l’air sur la tête des arbres, légère ligne blanche à l’horizon. Djamil ne cesse de se retourner sur sa couche, sa tête traversée d’obsessions, d’idées folles. Il entend la respiration calme et régulière de Lyubina, celle plus rapide et heurtée de Kalia. Il sait que sa femme ne dort pas, qu’elle pense à leur fille et ne trouvera le sommeil qu’au petit matin lorsque les brumes descendront des falaises et que la fatigue appuiera sur ses yeux, tels des bouchons d’étoupe.Djamil se lève, s’habille d’un pantalon de toile et d’une chemise. Dans le coffre accroché à la roulotte il saisit les collets en fil de laiton, les enfouit dans les profondeurs de ses poches. Dehors la nuit est claire, blanchie par la goutte figée de la Lune. Sur la gauche, les cases de ciment d’Autan dessinent d’étranges cubes pareils à des casemates ; à droite le treillis des grues se projette sur les murs des entrepôts. Djamil longe la Cité, monte le chemin de pierres qui conduit vers les carrières, contourne le « Volcan ». Ici la terre est maigre, semée de cailloux, hérissée de touffes de serpolet, de genièvres, de buissons noirs. Il en connaît toutes les sentes, les layons qui partent en étoiles, en nœuds, en ramifications multiples. Au hasard des touffes d’arbustes et de ronces, il plante des brindilles, les dispose en goulet au bout duquel le collet est tendu, accroché à une branche flexible. Parfois un lapin, un lièvre viennent s’y prendre, alors Djamilcueille un bouquet de plantes aromatiques, romarin, sarriette, origan et c’est comme un fumet généreux qui mouille ses papilles, fait gonfler sa langue, dilate son estomac. Mais les prises se font rares, les braconniers plus nombreux et les Roms sont souvent obligés de dénicher des écureuils, de traquer des hérissons qu’ils mettent à cuire dans une boule d’argile. Mais que serait la vie d’un Rom sans rapine, sans braconnage sinon une terre déserte et désolée ?
Djamil vient de poser son dernier lacet. Il s’assoit sur une butte de terre, roule une cigarette, frotte le briquet. Il rejette la fumée, longue ligne grise que dissipe l’air frais de la nuit. Tout en bas, dans la vallée, la Bastide est une tache claire que ceignent les remparts d’argile. Les yeux de Djamil sont fascinés par la vision si belle des trois ponts aux arches semblables, des hautes tours de briques, de la Place aux arcades où luisent les pavés noirs, de la terrasse du Café El Patio rythmée par les voiles blancs et noirs de ceux qui viennent y boire des breuvages glacés pareils à l’eau des lacs. Djamil fait taire les rumeurs qui l’habitent, prête l’oreille. Des sons viennent de la Bastide, sinuent dans les lacis du vent. On entend des sonorités d’accordéon, des plaintes de violon, des percussions de peau identiques aux vibrations sourdes du doba tsigane. La musique s’amplifie, roule sur les pavés inégaux, ourle le bord des fontaines, se coule dans les venelles, s’insinue au creux des cours ombreuses, s’enroule autour des lianes des volubilis et c’est maintenant une rumeur qui gagne la plaine d’herbes, les ruisseaux, les bosquets, les sources, jusqu’en haut de la falaise blanche.
Comme saisies d’ivresse les pupilles de Djamil se dilatent et il perçoit alors, sur les pierres noires qui jouxtent la terrasse d’El Patio, deux ombres tsiganes que la danse emmêle, alors que la pleine lune inonde le paysage d’une coulée de neige. Le rythme de la musique s’est accentué, est devenu plus vif sous les assauts de l’archet et ce sont maintenant les voix chaudes et voilées de Boti et de Lyubina qui résonnent à l’intérieur de l’enceinte de briques. Il regarde avec ferveur les mouvements amples et gracieux, les tournoiements des jupes rouges décorées de roses, la giration des foulards, l’éclat des lourdes créoles, les cercles des bijoux enserrant les bras, les chevilles, alors que les pieds nus font voler la poussière. Du Café El Patio sortent des salves de cris, d’exclamations, parfois de claquements de doigts, de coups de talons sur le sol de lave et il y a, dans l’air tendu, alors que le jour va poindre, une pluie de pièces d’or, à la façon des rayons du soleil lorsque le ciel s’habille de la teinte des feuilles. Les deux filles Roms remercient avec une sorte de révérence et leurs jupes rouges sont des corolles qui s’ouvrent sur l’éventail des dalles noires. La musique s’éteint en même temps que les dernières étoiles. Ceux de la Bastideregagnent leurs grandes demeures de pierre où bruissent encore les mélodies tsiganes. Une ligne claire décolore le ciel à l’horizon. Djamil quitte le chêne rouvre auquel il s’était adossé. En bas les maisons de ciment émergent peu à peu du sol couvert de gouttes d’eau. Les roulottes dorment encore dans les replis du Terrain vague.
« Demain Lyubina ira danser devant le Café El Patio » pense Djamil, et ses yeux brillent à la manière des veines d’or qui courent dans les profondeurs de la terre.
10 OCTOBRE.
Quatre longs jours sont passés depuis l’explication de Djamil et de Kalia. Quatre jours à errer au milieu des herbes folles, à tourner en rond entre les planches de la roulotte, à user son regard sur les murs d’enceinte de la Bastide. De longs jours à contenir ses sentiments, ses émotions, ses rancœurs parfois, à éviter le regard de l’autre, à retenir les mots tranchants, définitifs, pareils aux lames de silex. Puis le soir, alors que les ombres s’allongeaient sur le Terrain vague,Djamil a sorti du coffre la robe rouge à volants, la ceinture noire à longues franges parée de cercles de métal, le chemisier blanc, le boléro ourlé de dentelles, le foulard semé de roses. Il a posé sur la chaise le doba du père Dezso puis a fixé Lyubina de ses prunelles dures et noires comme l’obsidienne. L’adolescente a baissé les yeux en signe de soumission. Alors Kalia est sortie sur l’aire de bitume et la porte a longtemps battu sous les rafales du vent. Le père a frappé deux fois à la roulotte de Matéo-le-gitan. Matéo a ouvert. Ses deux visiteurs se sont assis sur les chaises de bois. Djamil n’a pas parlé. Le gitan a compris que l’heure était venue pourLyubina d’habiter son corps de femme, d’apporter sa contribution, de se relier à la tradition dupeuple Rom.
Il a sorti du buffet une bouteille d’eau-de-vie de baies sauvages, a rempli trois petits verres. Une odeur de genièvre et de prunelle a flotté entre les parois de la roulotte. C’était la première fois que Lyubina buvait de l’alcool. Elle l’a avalé d’un trait, à la manière des hommes, le liquide brûlant sa gorge. Elle aurait aimé avoir Boti à ses côtés mais son amie était allée chez la vieilleLuana jouer aux tarots et passer la nuit à lire l’avenir dans le marc de café et la figure mouvante des étoiles. Quand les réverbères se sont allumés dans la Bastide, Djamil a estimé que l’heure avait sonné pour Lyubina, qu’elle devait s’ouvrir à son destin. Il a pris congé de Matéo, a accompagné sa fille jusqu’à la limite des remparts. Déjà les premiers hommes habillés de blanc, les femmes en longues tuniques noires commençaient à remonter les rues en direction de la Place. Peu à peu la terrasse d’El Patio s’animait. On commençait à y servir des boissons fraîches, des verres de vin dorés comme du miel. L’odeur des mets grillés montait en lourdes nappes qui se dissipaient au milieu des feuilles argentées des oliviers et des eucalyptus. Une rumeur s’élevait de la terrasse, palpable, et c’est la Place entière, les arcades qui résonnaient maintenant de cris et de rires, et parfois le bruit hésitait, en suspens, comme si les gens de la Bastide attendaient un événement imminent. C’est le moment que choisit Djamil pour pousser légèrement Lyubina aux épaules. Sans se retourner la jeune fille s’engage sous l’arche de briques claire et, pieds nus, commence à remonter la rue conduisant au cœur de la Bastide. Sa longue robe rouge flotte autour de ses hanches menues, les lourds bracelets illuminent ses bras et ses chevilles, le doba au bout de ses mains fait un halo blanc comme celui de la lune. Puis elle s’engage sur sa gauche dans la venelle étroite qui débouche sur El Patio et disparaît aux yeux de son père. Djamil attend un instant, dissimulé dans l’ombre des remparts. Bientôt une voix sourde, voilée, monte vers le ciel, accompagnée des percussions rapides de la doba, du carillon cuivré des cymbales. Le Tsigane s’appuie au mur de briques et son esprit s’emplit de visions, de sons de toutes sortes qui semblent sortir des failles de la terre, des touffes d’herbe, des rochers blancs des falaises. Il voit, comme dans un rêve, les eaux vertes de l’Olt couler entre des gorges boisées ; les plaines de joncs du delta du Danube osciller sous la brise ; les collines abruptes des Carpates monter vers le ciel ; il voit des chevaux harnachés de rouge, des montreurs d’ours, des roulottes coloriées, des mendiants qui retournent des monceaux d’ordures ; il entend les chœurs de Roumanie, le grincement lancinant des violons, le souffle chaud et haletant de l’accordéon, la grêle cotonneuse de la contrebasse, les cascades de trilles de la guitare. Puis les sons s’amenuisent, se fondent comme s’ils étaient bus par la terre et il n’y a plus qu’un souffle lent et régulier qui longe l’assise des remparts.
Vaincu par la fatigue, Djamil s’endort, le front appuyé contre le tronc d’un arbre. Cependant que son mari courait poser ses lacets, Kalia, l’inquiétude au ventre, rejoignait la roulotte deLuana, alors que Boti dormait sur une banquette, pelotonnée dans une couverture de laine.Luana devina la confusion dans laquelle se trouvait la visiteuse. Elle lui servit une infusion de plantes qui l’apaisa un moment. Alors, dans une avalanche de mots, Kalia raconta tout : la rudesse de sa vie, le chômage, le projet fou de Djamil, la tentative de Lyubina, son entrée dansla Bastide, il y a quelques heures à peine, pour mendier ; l’avenir sombre, pareil à un nuage hostile qui se serait abattu sur le Terrain vague. Dans la roulotte que cerne la nuit, l’air est devenu lourd, presque irrespirable. Boti, sans doute en proie à quelque rêve agité mâchonne des mots incompréhensibles. Luana se lève, écarte le rideau qui dissimule une alcôve. Là, sur une étagère, une boule de cristal brille à la façon d’une étrange planète. Luana pose la boule sur la planche voilée de la table. Elle s’assoit face à Kalia. Peu à peu, dans le demi jour de la pièce étroite, le cristal semble vibrer, s’animer. Les ombres se nappent de clarté et bientôt des contours apparaissent, des détails émergent.
A l’intérieur de la sphère se trouve une sorte de ville miniature avec son damier de toits, son quadrillage de rues et de venelles étroites, ses places, ses fontaines, ses ponts aux arches multiples. Kalia, approchant son visage du cristal, n’a aucun mal à reconnaître la Bastide, ses deux tours symétriques, son mur d’enceinte, son chemin de ronde circulaire. La cité est déserte. Sur la Place dallée de pavés la fontaine projette sa gerbe d’écume. Un peu plus haut, sur la terrasse du Café El Patio, ne restent plus que des vestiges de la fête, vrilles des serpentins, pluie de confettis, serviettes maculées de taches. A l’écart, sur un cube de pierre noire, des objets queKalia reconnaît avec une sorte de ravissement teinté d’appréhension : cercle clair du doba entouré de ses cymbales, bracelets de cuivre, larges créoles touchées par la lumière. Kalia, que le spectacle fascine, ne peut détacher ses yeux des amulettes qui sont comme l’ombre, la projection de Lyubina.
Soudain le cristal s’assombrit, couleur de cendre, couleur de nuit. Alors Kalia sait qu’il ne sert à rien de rester dans la roulotte de Luana, qu’il lui faut rejoindre la sienne, derrière le talus d’herbes sauvages, là où est son destin. Elle remercie, part à la hâte, la démarche hésitante. A l’horizon, un jour gris et incertain se lève, sorte de frémissement coloré agitant les feuilles claires des bouleaux et des aulnes. A droite, sur le chemin de poussière, la silhouette hésitante de Djamil. Kalia et Djamil montent les trois marches de bois de la carriole. Ils n’échangent aucun mot, se couchant tout habillés sur les banquettes usées. Par la porte entr’ouverte pénètrent les premiers rayons du soleil. Ils viennent tout droit de l’est, du lointain pays des tsiganes, là où la mémoire des hommes se perd dans les brumes du passé.


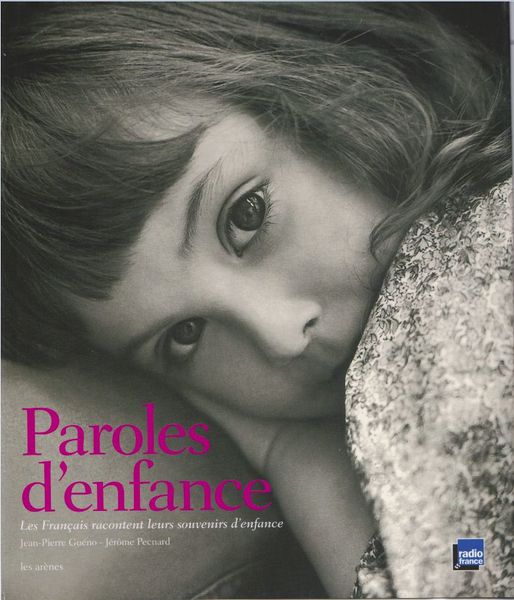



/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)