« Bonjour le jour...» – à Peyriac-de-Mer
Photographie : Hervé Baïs
***
Alba était le genre de petite fille qui passait inaperçue. Il faut dire, elle était mince telle la lame du couteau et ne faisait pas plus de bruit qu’une libellule volant dans la transparence de l’air. Elle était si discrète qu’elle ne différait guère de la feuille argentée du bouleau ou bien des fils de la vierge qui parsemaient le contour de l’étang. Quelqu’un se mettait-il en quête de l’apercevoir qu’elle était loin déjà, pareille au flottement de la brume dans une matinée d’automne. Pourtant elle n’était ni un rêve, ni une hallucination et vivait dans une petite maison du pêcheur perchée sur un promontoire de terre d’où l’horizon laissait découvrir sa belle et douce courbure.
Avait-elle des parents ? Nul ne le savait.
Allait-elle à l’école ? Personne n’aurait pu en témoigner.
A quoi passait-elle ses journées ? Il était impossible de le dire.
Peut-on décrire le vol blanc de la mouette dans l’indicible de l’heure ?
Peut-on évoquer la couleur du ciel lorsqu’il se confond avec la cendre ?
Cependant Alba ne se souciait guère ni de la parlotte des gens, ni du temps qu’il faisait, pas plus que des rumeurs qui se répandaient dans les rues des villes que l’on apercevait au loin, nimbées de lumière lorsque le soir venait. Parfois, au plein de la nuit, vissant sur ses yeux une paire de jumelles trouvée sur le sable d’une plage, elle scrutait les milliers de points brillants qui festonnaient les contours de la côte telle une guirlande. Jamais elle ne s’aventurait sur les places où s’agitaient les hommes, jamais elle ne fréquentait les rues du village au milieu des rires et des éclats de voix.
Elle était une fille des passages.
De la nuit au jour dans le bleuissement de l’aube.
Du jour à la nuit dans le cuivre du crépuscule.
Son occupation ? Engranger les mille et une visions du monde dans un coin de sa tête. Puis les convoquer dans les marges du rêve ou bien dans le coloriage, activité qu’elle aimait par-dessus tout. Elle était une manière d’archiviste du temps et de l’espace dont elle consignait les infinis événements sur des feuilles blanches qu’elle caressait de la pulpe des doigts avec une manière de ravissement.
L’hiver touche à sa fin. Parfois une blancheur sur les rives de l’étang, un fin liseré qui en cerne le contour. Parfois une journée plus chaude, estivale - elle aperçoit les hommes en chemise, les femmes en robes claires attablés aux terrasses des cafés -, et elle se risque à la limite du bruit et du mouvement, juste pour en éprouver la vive démangeaison, elle qui ne rêve que de lieux libres et sauvages, laissés au simple accroissement de leur être. Ce matin la clarté est haut levée qui fait ses ondes et ses balancements mais dans l’approche seulement et c’est le sentiment de l’immobile qui domine, l’impression d’une paix étendue sur les choses sans que nulle limite ne puisse l’atteindre. Assise en tailleur sur une touffe de laisses de mer, un livre posé sur ses genoux, Alba dessine. Ce qu’elle voit, qui est son domaine, celui aussi des gravelots à collier avec leur plumage à la teinte de plomb, leur œil vif si noir, celui des alouettes lulu et leurs plumes striées, leurs poitrines semées de points noirs.
Alba dessine et colorie le fin duvet du ciel qui ressemble au plumage des flamants roses. Son crayon court sur la feuille avec un léger grésillement. Elle aime bien ce genre de voix qui accompagne son geste. C’est comme une présence mais qui ne troublerait pas, serait là dans une attentive disposition. Parfois, du gras du pouce, la petite fille estompe une couleur trop vive qui pourrait déchirer le jour, sa venue d’organsin, ces fils si ténus qu’ils ne vivent qu’à être regardés, non touchés, effleurés et l’on pense à la chute de la feuille sur le sol de mousse. A la mine de plomb, que rehaussent quelques touches de crayon bleu, elle trace la ligne des collines, on dirait quelque enfant espiègle venu poser là un trouble dont il tirerait une secrète jouissance. Mais non, tout se fond et c’est comme un camaïeu de couleurs voisines, une diction sur le bout des lèvres, une effusion qui se retient au bord de sa parution.
De temps à autre, des bruits indistincts viennent du village. Ils sont de minces clapotis, le premier poème du jour qui vient. Ils ponctuent le temps, en scandent le rythme, ne l’altèrent pas. Ils sont identiques à un genre de contrepoint jouant en sourdine, donnant le ton de la scène, s’y superposant afin d’y correspondre, d’en rejoindre la félicité. Sur la grande nappe blanche qui traduit le miroitement de l’eau, Alba pose les cubes de cabanes lacustres, leurs reflets irisés, elle dessine le câble qui les relie à leur ancre, loin, là-bas dans le fond de vase où glissent les noires anguilles. Elle dessine des ribambelles de cormorans aux ailes déployées aux rémiges que la lumière traverse, ils ressemblent à des éventails. Elle dessine, sans presque s’arrêter, tout ce bonheur qui surgit et décline son nom selon de minces vibrations, de légers glissements, d’à peine frissonnements qui sont la nourriture du corps, l’ambroisie de l’âme. Alba ne sent rien que cette joie immédiate de créer. Elle n’a ni faim, ni soif. Elle est comme ces grands oiseaux qui planent longuement sans donner de coups d’ailes. Tout dans la facilité. Tout dans la netteté. Tout dans l’intelligibilité du réel, sa venue à soi tirée d’elle-même. Nul besoin d’un complément, d’une fioriture censés en accroître la dimension. Des fois, croisant ses doigts, les étirant, les faisant craquer, la jeune dessinatrice reprend conscience d’elle-même, sollicite son corps avant qu’il ne se fonde et ne disparaisse dans le paysage qui est son double, son écho, le seul interlocuteur avec lequel elle entretient un dialogue. Le bas de l’image, elle y applique un ton plus soutenu car il indique les profondeurs proches, le mystère de ces eaux où ne règnent qu’ombres et ténèbres. Voici, Alba vient d’accomplir le rituel au terme duquel s’amorcent ses journées. Le reste du temps, elle le consacrera à quelques retouches et, surtout, à de longues promenades songeuses tout autour de l’étang. Elle en connaît les moindres buttes, les plus minces recoins, les anses et les golfes qu’envahissent les tapis de santolines avec les grains jaunes de leurs fleurs. Le soir, lorsque le jour décline, que les ombres allongent leurs ailes sur les collines, que l’eau vire au violet, debout sur son promontoire, telle une vigie ou bien un génie tutélaire, Alba jette un dernier regard sur le territoire qui l’accueille comme l’une de ses filles. Puis elle entre dans son étroite maison badigeonnée à la chaux. Elle s’allonge sur sa natte. La lune est dans le ciel qui fait son lumineux croissant. Ses rayons caressent le doux visage de la petite fille. Le rêve est là, déjà, il porte sur le front, les lèvres, cette douce onction qui se nomme sommeil, ouvre les portes brillantes de l’imaginaire. Chut, Alba dort !



/image%2F0994967%2F20230925%2Fob_0dbb24_aaa-copier.jpg)

/image%2F0994967%2F20230113%2Fob_55f3d6_aaa-copier-copier.jpg)

/image%2F0994967%2F20230719%2Fob_b45535_aaa-copier-copier.jpg)
/image%2F0994967%2F20230718%2Fob_fabe03_aaa-copier.jpg)





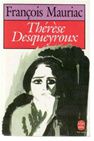
/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)