Il pleuvait sans cesse sur Cambo ce jour-là…
J’étais dans cette grande maison basque aux colombages de sang avec, sur la colline en face, la meute serrée des fougères et les touffes grises des moutons. Le ciel était si bas qui voilait les montagnes et l’herbe était phosphorescente avec, ici et là, des taches plus sombres. J’avais emporté ma boîte de couleurs et mes feuilles, mais rien ne s’imprimait dans l’évidence, simplement un fouillis coloré qui ne disait rien de l’instant présent. J’ai essayé de ruser, de tracer quelques lignes au fusain, de les user, d’évoquer avec quelques traits de graphite l’évanescence des choses. J’y parvenais si bien que rien ne figurait sauf l’absence et le vide. Certains jours il fallait se résoudre à ne pas exister. C’était douloureux de renoncer au langage des formes. Je crois plutôt que c’était elles, les formes, qui avaient renoncé à me visiter. Je suis sorti sur le balcon aux balustres ouvragés. J’ai fumé longuement, tâchant, par la pensée, de suivre les volutes d’air gris. Mais quel trajet faisait donc la création pour convoquer les muses ?
Une fine bruine semait sa cendre sur les arbres et le vaste ciel océanique semblait, soudain, avoir étréci à la taille d’un péché véniel. La rue était envahie de longues traînées fuligineuses, les voitures étaient rares, les passants glissaient le long de leurs ombres avec l’air distrait de quelqu’un qui vient de commettre un larcin. Les corolles des parapluies, colorées pourtant, semblaient des épouvantails que les intempéries auraient ternies. Le deuil s’emparait des choses à mesure qu’elles paraissaient. Partout, sur les allées, dans les rues, était la désolation. Les arbres se dépouillaient de leurs feuilles et les bogues des marrons regardaient le ciel vide où couraient les nuées. Tout était dans la perte, le non-savoir. Le rouge et le bleu des maisons se diluaient dans l’air chargé de brume. Loin, là-bas, sur la côte, soufflait le vent en longues rafales, se dressaient les vagues de schiste, se perdaient les songes des poètes. Il y avait tellement à saisir qui glissait entre les doigts. Nuées de sable que même la pensée ne pouvait faire siennes. Aux terrasses battaient les parasols qu’un lien tentait de retenir. Parfois un chien perdu arpentait le trottoir avec la truffe au ras du sol, les oreilles hurlant à la mort. On aurait dit qu’il pressentait quelque tragédie. Ou bien la perte était pour bientôt qui dissoudrait jusqu’aux nervures des feuilles.
Longtemps j’ai marché au hasard des rues, n’apercevant guère ce qui s’y inscrivait de la vie des hommes. La mienne, dans cette étonnante léthargie, suffisait à occuper le haut du pavé. Fallait-il que je sois soucieux pour n’observer que les remous de mon âme alors que la ville était belle dans son linceul de pluie ! J’ai longé un antique lavoir où, depuis longtemps, ne résonnait plus le battoir de bois qui usait le linge. Une rue d’escaliers descendait vers la vallée, bordée d’un caniveau qui dégorgeait et cascadait avec un bruit de ruisseau. Plus haut, dans le ciel perdu, quelques palmiers faisaient bouger leurs lames. J’entendais la Nive clapoter parmi les dalles de rochers. Je me souvenais d’autres automnes, radieux, lumineux avec la coupole du ciel incendiée et les feuilles des érables telles des torches. Plusieurs fois je m’étais assis sur la roche, regard tourné vers l’estuaire, vers l’océan où voguent les coques blanches des navires. Vers Bayonne la belle et ses quais aux hautes maisons ouvertes sur l’Adour. Mais Bayonne existait-elle encore ? Quels navires cinglaient vers quelles étranges destinations ? J’ai remonté la rue en pente, dépassé par de rares voitures aux passagers anonymes. Bientôt le Parc des Thermes, ses massifs, ses gloriettes, ses allées de tuileaux architecturés, sa chapelle aux ferrures ouvragées. La pluie, le gris, allaient si bien à cette ambiance Belle Epoque, au charme désuet et un rien prétentieux de la ville d’eau. Oui, d’eau.
Le Pavillon Bleu m’attendait avec ses tuiles vernissées couleur pervenche, sa rotonde blanche, sa forêt de palmiers comme une oasis. Je suis entré. La grande salle était vide. Une musique discrète planait avec la discrétion d’un vol de libellule. Je me suis assis sur un fauteuil de rotin, face à la Nive. Sur les tables de bois brut couraient des longères basques rayées de bleu et de blanc. Un serveur vêtu de noir est venu prendre ma commande. La pluie tombait sans discontinuer, pareille à un voile, à une vitre qui serait venue du ciel à la rencontre de la terre. Le thé était chaud, légèrement parfumé à la bergamote. Un gâteau du pays, doré comme du miel, l’accompagnait. J’étais bien, là, au creux de mes pensées. J’ai sorti de ma poche un crayon et un carnet de croquis. J’ai dessiné. Les traits se posaient dans une manière d’évidence sur la surface blanche. Parfois, entre deux bouchées, j’estompais du doigt les hachures ou bien quelque volute qui me paraissait trop affirmée. Le garçon est venu m’apporter la note. Je le voyais, intrigué, essayant de deviner au-dessus de mon épaule l’objet de ma passion. Gêné mais heureux il a longuement observé l’évolution de mon œuvre. Puis il a paru confus : « Mais, il n’y a rien, sur votre feuille ! »
J’ai fait mine de ne pas comprendre, j’ai bu ma dernière gorgée de thé, ai réglé ma note. La pluie, dehors, avait cessé. De grands lambeaux de toile grise s’effilochaient devant les bâtiments des soins. Sur les balcons, quelques personnes bavardaient. Parfois des éclats de rire. Je suis passé devant le kiosque à musique. Il y avait, dans l’air, comme une saveur nouvelle, la dernière lueur avant que le soleil ne s’efface. J’ai poussé la porte de la maison. J’ai jeté mon carnet sur le bureau. La nature respirait après ce déluge. Les arbres étiraient leurs branches à la manière d’ombres chinoises sur un fond parme. Subitement je me sentais heureux, envahi d’une plénitude dont je connaissais la cause mais différais le moment de sa révélation. Il y a des instants dont la valeur est, essentiellement, de durer. Ils ressemblent alors à une éternité. Dans le réfrigérateur dormait une bouteille d’Irouléguy. Le vin blanc était presque doré derrière son verre teinté. J’ai bu, à petite gorgées cette manière de nectar des dieux. La boisson collait au palais avec une belle ardeur. Je me suis assis sur le balcon face aux montagnes. Elles étaient maintenant dans une belle lumière pareille à la croûte de pain avec une frange légèrement plus claire à la limite du ciel. J’ai allumé une cigarette. La fumée montait droit dans la fraîcheur qui gagnait. J’ai feuilleté les pages de mon carnet de croquis. C’était écume et blancheur virginale. Observant des oiseaux décrivant dans le ciel leurs frêles arabesques, j’ai esquissé un franc sourire. Jamais je n’avais dessiné l’absence avec une telle maîtrise ! Jamais.
Il pleuvait sans cesse sur Cambo ce jour-là…





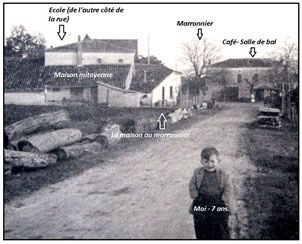














/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)