« Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots ».
Œuvre : André Maynet.
Présence virtuelle.
Secrète était ainsi faite que nul, en réalité, ne la connaissait. Ce qu’on savait d’elle, ceci : elle était habillée d’une vêture sombre, genre de robe de communiante arborant un sage col blanc dont on pensait qu’il était amidonné. Certains prétendaient que sa tenue était plutôt celle d’une soubrette mais d’un genre sérieux. On l’eût volontiers vue officier dans quelque confrérie à la stricte vie conventuelle, sans doute en tant que récitante d’un oratorio voué aux mystères d’une étrange liturgie. Ses journées, elle les passait dans l’ambiance grise d’une chambre (était-ce une cellule monastique ?), plantée derrière un pupitre à partition, tenant en sa main gauche un microphone relié à un long fil dont on ne connaissait l’épilogue. A l’arrière-plan, un autre pupitre de guingois se confondait avec le sol qui ne paraissait être que de brume. Ce qui surprenait le plus dans cette bizarre composition, c’était le genre de contradiction qui s’établissait dans la scénographie entre la possible mise en acte d’une parole et la mutité de la scène. En effet, tout dans l’attitude de Secrète semblait l’incliner à n’être qu’une présence virtuelle, un personnage demeurant dans une gangue illisible. On eût pensé à une Colombine au visage enduit de plâtre (les Mimes en arborent de semblables), figée dans une impossible mission, bras sagement disposés le long du corps, fûts des jambes si transparents qu’on l’eût crue évadée d’un songe ou bien de quelque conte fantastique.
Qui était-elle ?
Mesurait-elle l’écoulement du temps ? Etait-elle une discrète géomètre chargée d’arpenter l’espace ? Etait-elle l’officiante faisant face à un auditoire dont on aurait pu penser qu’il s’agissait de types semblables aux illusoires mannequins d’osier d’un Giorgio de Chirico ? Ou bien n’étaient-ils que de sombres tubercules, des assemblages de fruits et de légumes, tels qu’imaginés par le génial Arcimboldo ? Ou bien encore ceux qui étaient invisibles n’étaient-ils que des grotesques de la Renaissance, de vulgaires empilements de pierres et de moignons dans un jardin empli de l’humidité poisseuse des grottes ? En vérité on n’avait guère que la ressource d’un imaginaire hardi pour répondre à une question qui, peut-être, n’avait aucun sens. Mais émettre des hypothèses était toujours mieux que de laisser son intellect voguer avec des voiles faseyant au vent du grand large !
Ne chantait pas.
Toujours est-il qu’on ne pouvait guère avancer que de supputations en conjectures, c'est-à-dire marcher d’un pied sur l’autre sans être bien conscient d’avancer. Ce qui, cependant, devenait certain à l’aune d’une longue observation, c’est que Secrète avait hérité son nom avec la justesse qui sied aux exactes suppositions. Rien ne filtrait d’elle, sinon cette attitude hiératique, genre d’énigmatique hiéroglyphe avec lequel il fallait s’entendre à défaut de tirer de la Récipiendaire une explication qui eût été éclairante. Non seulement elle ne chantait pas mais une investigation à peine approfondie en livrait quelques secrets. Elle n’aimait nullement la vastitude de la symphonie, son air d’emphase. L’opéra, elle n’en éprouvait guère le faste et la démesure lyrique de ses acteurs ne faisait naître en elle nul frisson. De l’opérette elle ne retenait ni le côté bouffon, ni le constant vaudeville, pas plus que les excentricités musicales qui en tissaient la tessiture. L’oratorio lui paraissait exagérément teinté de drame religieux et les récitatifs de ses solistes trop datés se montraient à la manière d’une esthétique anachronique. La sonate était trop baroque, l’adagio d’Albinoni usé d’avoir été infiniment écouté. Le concerto la déconcertait par son caractère virtuose.
Seule la fugue.
Seule la fugue trouvait grâce à ses yeux (sans doute à ses oreilles), tout simplement en raison de ce procédé de « fuite » où le thème est une esquive d’une voix à l’autre comme s’il s’agissait d’un fluide, d’une nature presque insaisissable, à la limite d’une perception. Elle aimait ces notes suspendues pareille à des gouttes d’eau s’écoulant de la margelle d’un puits, longue hésitation avant que de se détacher, d’entraîner à sa suite d’autres hésitations, d’autres notes que le silence tenait en sustentation. Elle y voyait l’essence même du temps, la trame de l’espace, l’écriture de l’existence faite de mots puis d’arrêts, de marches en avant, de brusques retours en arrière, de réminiscences, puis un nouveau bond, un nouveau silence. Et ce qu’elle savait d’une façon aussi intuitive que sans doute corporelle, c’était la valeur à nulle autre pareille de la pause, de l’intervalle, du passage d’un point à un autre de la parole (car la musique n’était que cela : parole et rien d’autre), autrement dit du SILENCE. Etrange paradoxe tout de même que la valeur insigne du silence par lequel le langage apparaît en son il est. Car abstraction faite du silence qui tisse les mots entre eux, ne se fait plus percevoir qu’un bourdonnant bruit de fond, qu’une entêtante rumeur, qu’un incompréhensible sabir dont rien ne peut plus signifier. Or tout est sens qui doit tisser la vie. Or tout est signe qu’encadrent deux aires de repos. Deux sites de silence. Silence, silence, silence proféré trois fois comme pour lui donner de la chair, de l’épaisseur, du volume, de la présence. En réalité on n’écoute que cela, le silence. Les voix, les paroles, les déclamations, les déclarations, les exhortations, les dénégations, les discours, les harangues, les éclats sonores des bateleurs et autres bonimenteurs ne sont que des ronds dans l’eau qui trouent le silence. Cessez de jeter une pierre et c’est le silence qui adviendra car lui seul a la précellence. De lui naît la parole et non l’inverse. A preuve l’immense désert qui croît dès l’instant où le monde ne profère plus. L’état originel c’est l’avant-mot, l’ante-verbe, la coupure dans le discours, le vide qui assemble et porte au jour ce qui, autrement, ne serait que nuit dense, ombre impénétrable.
Les plus heureux sont silencieux.
Ici, il faut jouer avec l’assertion Poète et en prolonger le dire au risque de faire acte de violence. Mais violence apparente car au travers de la poésie, c’est le silence lui-même qui est en cause. Ce que nous dit Musset dans cette belle langue pathétique, il est nécessaire d’en traverser le sens afin d’en découvrir le langage crypté. Tout langage poétique est de cette sorte qu’il véhicule en lui plus de contenu qu’il ne propage de mots explicites. Toujours de l’implicite. Toujours caché. Sinon ce ne serait plus que la prose du quotidien et la saisie immédiate de ce qui se montre, le plus souvent une contingence qui ne mérite guère attention.
Mais reprenons ces deux vers d’anthologie :
« Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots »
Et prolongeons le rêve du Poète en ajoutant deux autres vers
qui pourraient en compléter le sens :
« Les plus heureux sont silencieux,
Et j’en connais qui sont de purs joyaux ».
S’agit-il, ici, de pure fantaisie ou bien y a-t-il quelque chose à extraire de cet ajout qui, sinon, pourrait prendre la figure de l’iconoclasme ?
Ce qui a été accentué consiste en ceci : Les chants les plus beaux sont silencieux ; ils sont de purs joyaux.
Si les deux premiers vers de Musset évoquent le thème romantique de la douleur en tant que ressort de la création, ils doivent nécessairement être rapportés à une esthétique du sanglot qui ne peut viser que la sphère la plus intime du Poète, seul dans sa chambre, face au silence d’où va naître l’œuvre sublime. Ici surgit à nouveau, comme en contrepoint, le suspens de la fugue. Chaque mot tissé par l’auteur est suspendu, en attente du précédent qui va le révéler, du prochain qui en sera la forme d’accomplissement. Chaque mot pareil à un joyau que, seule la mutité fera resplendir. Le langage poétique est une telle transcendance qu’il faut le secret de la crypte, le mystère du temple, la méditation profonde, la contemplation de la chose rare, tout ceci n’ayant jamais lieu qu’à l’écart du « bruit et de la fureur ». Certes, sans doute fureur intérieure, passion, flamme par laquelle le mot devient incandescent et resplendit telle une gemme dans le ventre fécond de la terre.
Ami d’une source claire.
Nul n’irait imaginer Poète versifiant parmi les déambulations d’une foule bruyante ou bien face au vacarme de quelque industrie. Toujours le Poète est l’ami d’une source claire, d’un frais vallon, d’une crête à peine touchée par la lumière, d’un clair-obscur qui est silence de la lumière. Toujours ce retrait, cette marche sur la pointe des pieds. Mots de l’effleurement et de la grâce discrète, mots à fleurets mouchetés, mots d’étoupe faisant leurs inaperçus pas de deux alors que le monde s’agite et convulse. Tout Poète authentique est l’antidote des violents soubresauts d’une vie qui brasse l’immense marée humaine. Mots du reflux et du dire à rebours, mots pareils à une écume qui demeurent au ciel du monde alors que l’eau s’est déjà retirée vers les hauts-fonds. Mots qui ne disent qu’à se soustraire au dire. Mots qui ne sont mots qu’à être reliés par le silence, leur matière première, l’origine qui les fait être l’exception qu’ils sont. Et puis, la poésie, où est-elle la plus vraie, la plus vivante ? Dans le verbe haut qui la déclame et la met en scène pour un public qui en attend un ravissement ? Ou bien dans la lecture qui reproduit silencieusement l’acte créateur qui présida à sa naissance ? Sans doute une lecture méditante est-elle la plus à même d’approcher ce qui, par essence est indicible et qui pourtant se dit : EN SILENCE !







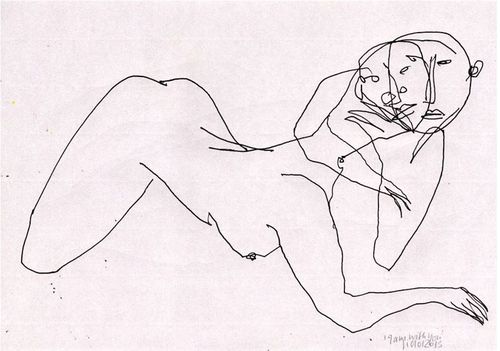










/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)